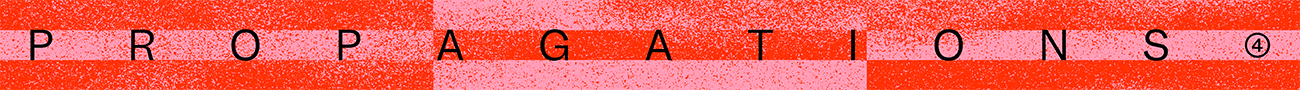Lili Reynaud-Dewar fait un hold-up dans le magasin des formes de l’art moderne, sur un fond sonore de pop synthétique. Et expose, à la galerie RLBQ, des sculptures qui pervertissent l’abstraction avec un goût déviant de la magie noire et de la décoration d’intérieur
Lili Reynaud-Dewar fait un hold-up dans le magasin des formes de l’art moderne, sur un fond sonore de pop synthétique. Et expose, à la galerie RLBQ, des sculptures qui pervertissent l’abstraction avec un goût déviant de la magie noire et de la décoration d’intérieur
 « Est-ce que la modernité est notre antiquité ? » Au programme de la prochaine Documenta (le plus important des rendez-vous de l’art contemporain qui aura lieu durant l’été 2007 à Kassel), cette question propose d’analyser l’influence que continuent d’exercer les avant-gardes de l’art moderne sur la création actuelle. Si leur capacité à imprégner les formes d’une vision, parfois d’un projet utopique – des constructivistes russes au minimalisme – a été mise à distance par le “pluralisme” et les postures ironiques de la post-modernité, il reste que leur vocabulaire formel a gardé un potentiel vertigineux que de nombreux artistes s’emploient actuellement à réactiver. Sans nostalgie pour autant, et sortant des prés carrés restrictifs des programmes du modernisme, à travers des collisions (abstraction et symbolisme, minimalisme et art brut…) et contaminations, allant du design automobile à l’histoire de la musique pop. C’est d’ailleurs un album de New Order, l’un des groupes emblématiques de la “corruption” du punk par l’industrie culturelle au début des années 80, qui donne le titre de l’expo de Lili Reynaud Dewar à la galerie RLBQ : Power, Corruption & Lies. Inscrits sur des affiches aux couleurs du drapeau rastafari, ces mots jouent sur l’ambiguïté d’un slogan politique dénonciateur, mais une autre lecture se dégage, moins dans le champ de la résistance que dans celui de l’assimilation, en rapprochant deux cultures musicales dissonantes, l’une blanche et l’autre noire. A l’image de la new-wave anglaise, il s’agit ici d’abandonner les idéaux de pureté et d’authenticité pour placer l’art dans une renégociation permanente face à la “corruption” des produits de l’industrie culturelle. Encadrée au mur, une photographie publicitaire donne à voir une voiture de sport, la Lamborghini Marzal, qui est restée un prototype, incarnant une vision datée d’un design futuriste. Mise en abîme du statut de l’objet d’art en tant que catalyseur des désirs d’une industrie du luxe, assimilée à la décoration d’intérieur, cette image fait face à une sculpture géométrique rappelant un paravent. De la même façon que la voiture dévoile ici son intérieur par une coupe dans sa coque, le “paravent” perd toute fonctionnalité, étant composé de deux surfaces de verre articulées qui n’offrent pas d’obstacle au regard. Vitrine ? Si cette sculpture peut évoquer les dispositifs réfléchissants de Dan Graham, elle fait surtout écran à toute interprétation, s’imposant dans l’espace de façon à constituer un blocage (y compris à notre passage). Une sculpture qui chercherait à reprendre l’autonomie des formes de l’art moderne? Une abstraction sacrifiée aux normes ornementales de la décoration d’intérieur? Intégrée aux extrémités de l’oeuvre, une photo d’un petit garçon dépité surgit comme une intrusion qui vient perturber toute lecture formaliste. Extraite d’un film de l’artiste japonais Arakawa, qui suivait cet enfant alcoolique dans les rues de New York, il s’agit néanmoins d’un faux documentaire, nous interrogeant ici sur la prétention des images à une quelconque valeur de vérité. Ces éléments contradictoires sont mis en parallèle avec une réflexion critique sur les codes décoratifs en sculpture, renvoyant ironiquement l’usage bourgeois d’un art abstrait à la valeur fétichiste d’un bibelot. Le décoratif, en tant qu’éternel repoussoir sous-jacent à l’histoire de l’abstraction, souvent renvoyée au principe de l’art pour l’art, devient ici un procédé critique que l’artiste investit de façon maniériste, faisant état d’une décadence. Dans une deuxième salle, on passe de New Order à Joy Division, dans une atmosphère sombre qui amène l’ensemble des sculptures du côté d’un rituel archaïque proche de la magie noire : deux sphères font face à un autel gothique, réalisé avec des couches de bois en contreplaqué brûlé. Des formes triangulaires découpées sur un tissu accroché au mur créent un effet de symétrie inversé avec la salle d’à côté, contaminant l’ensemble avec une surcharge de signes contradictoires. Pourtant, ici la sculpture ne cherche pas à faire allusion à l’objet « commun », et son mysticisme pervers exploite et déforme les formes déclinées par l’art moderne « auratique » dans une version déviante, ornementale et baroque. L’abstraction est ici devenue un puissant moteur à récits, à la fois complexe et contradictoire, qui affirment la puissance des formes à subvertir les codes culturels.
« Est-ce que la modernité est notre antiquité ? » Au programme de la prochaine Documenta (le plus important des rendez-vous de l’art contemporain qui aura lieu durant l’été 2007 à Kassel), cette question propose d’analyser l’influence que continuent d’exercer les avant-gardes de l’art moderne sur la création actuelle. Si leur capacité à imprégner les formes d’une vision, parfois d’un projet utopique – des constructivistes russes au minimalisme – a été mise à distance par le “pluralisme” et les postures ironiques de la post-modernité, il reste que leur vocabulaire formel a gardé un potentiel vertigineux que de nombreux artistes s’emploient actuellement à réactiver. Sans nostalgie pour autant, et sortant des prés carrés restrictifs des programmes du modernisme, à travers des collisions (abstraction et symbolisme, minimalisme et art brut…) et contaminations, allant du design automobile à l’histoire de la musique pop. C’est d’ailleurs un album de New Order, l’un des groupes emblématiques de la “corruption” du punk par l’industrie culturelle au début des années 80, qui donne le titre de l’expo de Lili Reynaud Dewar à la galerie RLBQ : Power, Corruption & Lies. Inscrits sur des affiches aux couleurs du drapeau rastafari, ces mots jouent sur l’ambiguïté d’un slogan politique dénonciateur, mais une autre lecture se dégage, moins dans le champ de la résistance que dans celui de l’assimilation, en rapprochant deux cultures musicales dissonantes, l’une blanche et l’autre noire. A l’image de la new-wave anglaise, il s’agit ici d’abandonner les idéaux de pureté et d’authenticité pour placer l’art dans une renégociation permanente face à la “corruption” des produits de l’industrie culturelle. Encadrée au mur, une photographie publicitaire donne à voir une voiture de sport, la Lamborghini Marzal, qui est restée un prototype, incarnant une vision datée d’un design futuriste. Mise en abîme du statut de l’objet d’art en tant que catalyseur des désirs d’une industrie du luxe, assimilée à la décoration d’intérieur, cette image fait face à une sculpture géométrique rappelant un paravent. De la même façon que la voiture dévoile ici son intérieur par une coupe dans sa coque, le “paravent” perd toute fonctionnalité, étant composé de deux surfaces de verre articulées qui n’offrent pas d’obstacle au regard. Vitrine ? Si cette sculpture peut évoquer les dispositifs réfléchissants de Dan Graham, elle fait surtout écran à toute interprétation, s’imposant dans l’espace de façon à constituer un blocage (y compris à notre passage). Une sculpture qui chercherait à reprendre l’autonomie des formes de l’art moderne? Une abstraction sacrifiée aux normes ornementales de la décoration d’intérieur? Intégrée aux extrémités de l’oeuvre, une photo d’un petit garçon dépité surgit comme une intrusion qui vient perturber toute lecture formaliste. Extraite d’un film de l’artiste japonais Arakawa, qui suivait cet enfant alcoolique dans les rues de New York, il s’agit néanmoins d’un faux documentaire, nous interrogeant ici sur la prétention des images à une quelconque valeur de vérité. Ces éléments contradictoires sont mis en parallèle avec une réflexion critique sur les codes décoratifs en sculpture, renvoyant ironiquement l’usage bourgeois d’un art abstrait à la valeur fétichiste d’un bibelot. Le décoratif, en tant qu’éternel repoussoir sous-jacent à l’histoire de l’abstraction, souvent renvoyée au principe de l’art pour l’art, devient ici un procédé critique que l’artiste investit de façon maniériste, faisant état d’une décadence. Dans une deuxième salle, on passe de New Order à Joy Division, dans une atmosphère sombre qui amène l’ensemble des sculptures du côté d’un rituel archaïque proche de la magie noire : deux sphères font face à un autel gothique, réalisé avec des couches de bois en contreplaqué brûlé. Des formes triangulaires découpées sur un tissu accroché au mur créent un effet de symétrie inversé avec la salle d’à côté, contaminant l’ensemble avec une surcharge de signes contradictoires. Pourtant, ici la sculpture ne cherche pas à faire allusion à l’objet « commun », et son mysticisme pervers exploite et déforme les formes déclinées par l’art moderne « auratique » dans une version déviante, ornementale et baroque. L’abstraction est ici devenue un puissant moteur à récits, à la fois complexe et contradictoire, qui affirment la puissance des formes à subvertir les codes culturels.
Pedro Morais
Jusqu’au 25/03 à la Galerie RLBQ