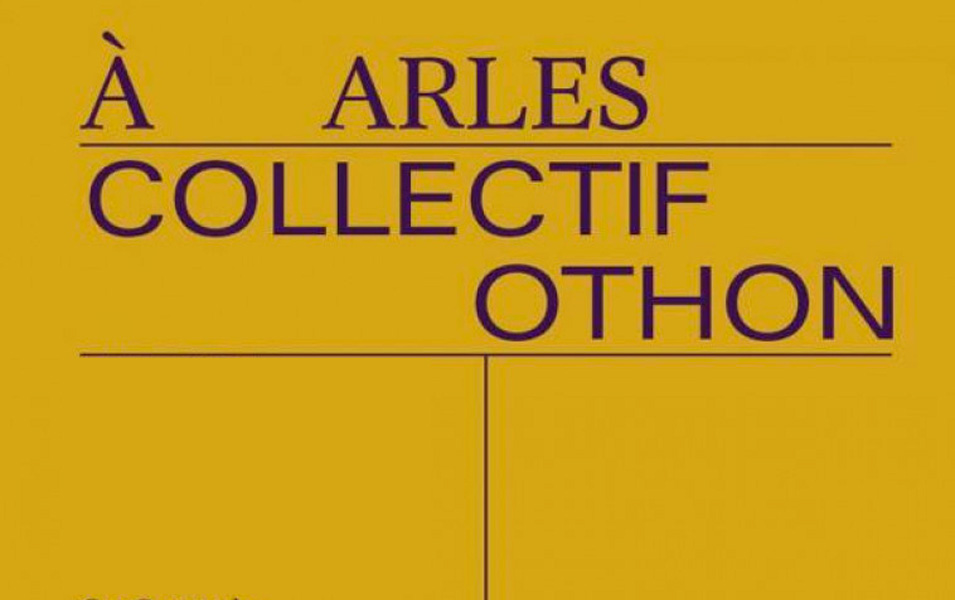
Millefeuille | À Arles par le Collectif Othon
Logement de fortunes
Avec son recueil de textes À Arles, le Collectif Othon commet l’anti-guide touristique imparable. Égratignant les discours creux du capitalisme social et greenwashé, il révèle une tout autre réalité arlésienne, beaucoup moins reluisante.
 Le Collectif Othon, c’est l’association de douze compères (onze pour l’exercice À Arles) motivés par l’envie de réfléchir aux questions d’urbanisme et de démocratie à échelle locale. Dans les années 2000, cette ambition a donné lieu à plusieurs films et deux documentaires, avant que le dispositif ne change. Aujourd’hui, l’équipe déambule partout en France, ciblant tout ce que le pays compte de petites et moyennes villes. Sous-préfectures en mal d’amour, piégées dans la toile des grosses métropoles, pour qui les affres de la relégation territoriale confinent bien souvent à l’obsession. Le collectif y rencontre les habitants, des gens « lambda ou moins lambda », y cible « quelques lieux et institutions », y épie les coutumes, les usages et les traditions locales. En résulte des livres polyphoniques, dont le style se détache du journalisme académique pour se rapprocher de la non-fiction littéraire. En 2020, il y a ainsi eu À Valencienne ; en 2023, il y a désormais À Arles.
Le Collectif Othon, c’est l’association de douze compères (onze pour l’exercice À Arles) motivés par l’envie de réfléchir aux questions d’urbanisme et de démocratie à échelle locale. Dans les années 2000, cette ambition a donné lieu à plusieurs films et deux documentaires, avant que le dispositif ne change. Aujourd’hui, l’équipe déambule partout en France, ciblant tout ce que le pays compte de petites et moyennes villes. Sous-préfectures en mal d’amour, piégées dans la toile des grosses métropoles, pour qui les affres de la relégation territoriale confinent bien souvent à l’obsession. Le collectif y rencontre les habitants, des gens « lambda ou moins lambda », y cible « quelques lieux et institutions », y épie les coutumes, les usages et les traditions locales. En résulte des livres polyphoniques, dont le style se détache du journalisme académique pour se rapprocher de la non-fiction littéraire. En 2020, il y a ainsi eu À Valencienne ; en 2023, il y a désormais À Arles.
La méthode Othon n’est pas sans rappeler les formes canoniques des dérives situationnistes : une pratique que le philosophe Guy Debord théorisait comme un mode de déplacement dans l’espace urbain, libéré des effets de routine et attentif aux sollicitations du terrain. « Par le titre À Arles les auteur·ices signifient qu’ils sont allés dans la ville d’Arles, et qu’ils en ont rapporté, non pas une oreille de taureau, mais un livre », écrivent-ils. Chaque rédacteur·ices restitue son « bout de ville » : une fête du parti communiste local, les toilettes de la Tour Luma, les élucubrations d’un patron de bar, les colonnes du journal local, les propos d’une directrice d’agence d’intérim, etc. Des fragments d’Arles, saisis à la volée, dans une subjectivité toute assumée. La mise en mots court sur presque 200 pages, découpées en 25 textes.
Fait marquant qui n’aura pas échappé au collectif : Arles est devenue, en quelques années, le repaire pour la jet-set culturelle fortunée, venue de Paris et d’ailleurs. En témoignent les fastueuses rencontres organisées par les « Napo », deux enfants la pub réunissant chaque année, à la période estivale, la crème des chefferies d’entreprises, du marketing et de la communication du monde entier. En effet, si la ville a toujours été un spot touristique — monuments à arcades, festival de la photographie, jeux taurins —, elle abrite aujourd’hui un tout nouveau type de produits d’appel : la tour Luma, amas d’inox et de verre de 56 mètres de haut voulu par la riche héritière Maja Hoffmann. Si le dispositif donne un peu le vertige, il attire néanmoins le chaland. À l’instar du nombre de résidences secondaires dans l’hypercentre, les prix de l’immobilier explosent partout sur le territoire. « Il y a dix ans, tout le monde s’en foutait d’Arles, et puis il y a eu une mode, l’investissement dans la culture, les Rencontres photographiques, la Tour Luma, et là boum ! », commente un agent immobilier un peu azimuté auprès d’un rédacteur d’Othon. De ces anecdotes, le livre en regorge : une manière pour les auteurs de faire sourire leur lecteur, en montrant partout ailleurs sur quelle bulle de rien s’est construit ce délire spéculatif.
En effet, ce que À Arles restitue entre les lignes, c’est une ville pour partie piégée dans les fantasmes excentriques de sa baronnie locale. Maja Hoffmann, et sa quincaillerie Luma, est certes la milliardaire tendance du moment, mais son papa avant elle avait déjà amplement ouvert le bal. Dans les années 50, Luc Hoffmann, héritier de l’empire pharmaceutique du même nom, écologiste, philanthrope et ornithologue à ses heures, faisait main basse sur quelques lucratives parcelles de Camargue. Dans les années 70, c’est la famille Nyssen qui œuvrait à sa fable de « petit éditeur de région » — très rapidement devenu la puissante maison Acte Sud. Et faut-il remonter le temps jusqu’à Falco de Baroncelli, le propriétaire terrien adorateur du Far West et de Buffalo Bill, qui habillait ses vachers en costumes inspirés des Wild West Show, devenu depuis, motif du folklore local ? Dans son livre, Othon retrace l’histoire, non sans drôlerie, de ces riches fantaisistes qui escamotent, falsifient et altèrent tout.
Culturellement colonisée par la bourgeoisie, la ville d’Arles est partout support de son idéologie. La comédie qu’on y joue est celle du tout-culturel, discours tarte à la crème sur l’amour de l’art et le respect de l’environnement compris. Pour le Collectif Othon, il s’agit de démolir, avec humour, mais proprement, cette trop impeccable vitrine culturelle. Les discours officiels, les promesses de gloire et de prospérité, laissent dès lors place à une autre réalité. Alors qu’en France, le chômage est autour de 7 %, à Arles, il avoisine les 10 %. En outre, 23 % des 53 000 Arlésiens vivent sous le seuil de pauvreté, contre environ 15 % dans le reste du pays. Arles est une cité au passé traumatique : fermeture des ateliers SCNF dans les années 80, inondations en 2003, perte de l’usine Lustucru dans la foulée, puis de l’usine d’emballages Linpac et de la papèterie Étienne… Depuis, si millionnaires et milliardaires affluent du monde entier pour se jeter sur les petites boutiques, les galeries d’art, les musées et autres restaurants chics, leur argent ne semble pas pour autant ruisseler jusque dans les quartiers populaires du Trébon, de Griffeuille ou de Barriol.
Le collectif choisit de donner de la voix « aux petits personnels » de ces messieurs dames. Ceux qui sont là pour « les servir dans un restaurant camarguais, changer et laver leur linge d’hôtel, pour surveiller les salles dans la Tour, pour astiquer les vitres de leurs galeries, pour carreler leur tropézienne, pour les accueillir à la salle de fitness, pour les coacher à la salle de muscu, pour ramasser les ordures, etc. ». Il prête l’oreille à un balayeur d’origine algérienne, qui n’en peut plus des « boulots en confettis » proposés par la Ville, à une libraire exaspérée de la montée en gamme du centre-ville, qui « enrichit et désole » tout, et à Vincent, désabusé mais flamboyant, qui propose un dernier tour d’histoire d’Arles, et de son prolétariat vaincu.
Fuir ou rester ? Quand un couple de disquaires et leur bande de copains organisent un festival de musique gratuit, on finit par leur confisquer le lieu. À la Ville, les agents territoriaux doivent ramer pour qu’on ne supprime pas leurs emplois. Dans le quartier du Trébon, la peinture écaillée des balcons, les paraboles rouillées, et le linge pendu aux fenêtres plantent le décor. Quant au Parti communiste, autrefois localement fort, il ne semble plus être que l’ombre de lui-même. Fuir ou rester ? En sous-texte, les rédacteurs discutent la question et se répondent. Le livre termine sur une anecdote envoûtante, quasi surnaturelle, à la nécropole des Alyscamps, la « cité des morts vertueux ». Une histoire de vieux sarcophages profanés par des décennies de capitalisme, racontée depuis l’au-delà à une fillette des années 80. Cet ultime épisode achève le récit sur une sombre prophétie : on n’altère peut-être pas aussi impunément un territoire issu de plus de 2 000 ans d’histoire.
Gaëlle Desnos
À lire : À Arles du Collectif Othon (éditions Divergences)
