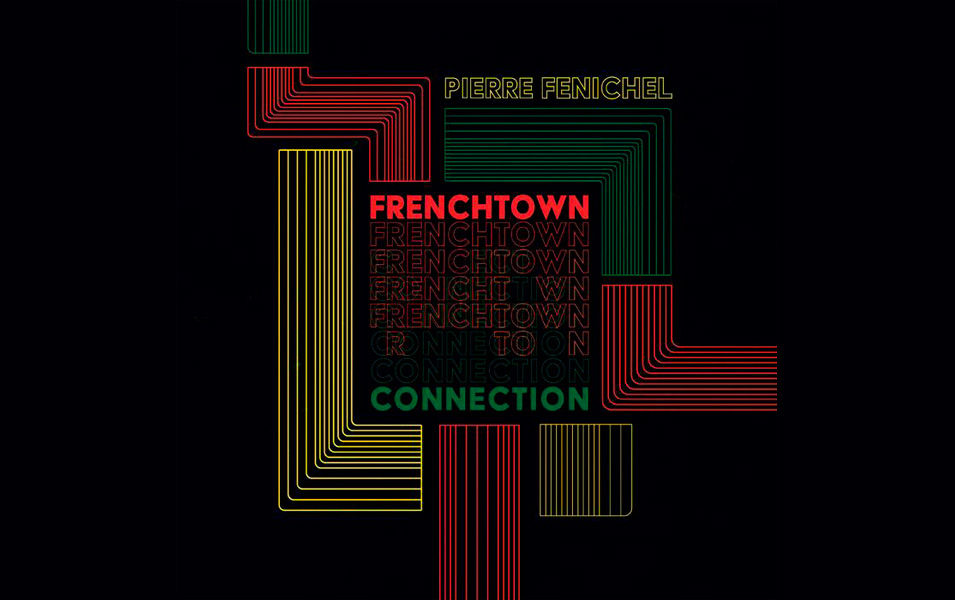
Galette | Frenchtown Connection de Pierre Fénichel
Jahzzman
Bomboclaat, comme disent les Jamaïcains ! C’est ainsi qu’à Yard (le surnom que les insulaires donnent à la Jamaïque) l’on marque sa stupéfaction.
Or, stupéfait, on ne peut que l’être à l’écoute du dernier album du contrebassiste marseillais Pierre Fénichel, Frenchtown Connection, sorti à l’automne dernier sur le label Durance.
Ce compagnon de route de Raphaël Imbert, membre de la Compagnie Nine Spirit, nous avait enchantés par le précédent opus qu’il avait réalisé en leader, en hommage au saxophoniste Paul Desmond (en trio avec guitare, batterie et sans sax’, il avait réussi à restituer la puissance émotionnelle de l’altiste dont l’histoire a retenu le compagnonnage avec Dave Brubeck – Breitenfeld, 2016). Ici, il nous ravit par ce mix yardie concocté à partir de l’imaginaire de l’adolescent qu’il était dans la cité phocéenne. Car, on le sait, Marseille et le reggae, c’est toute une histoire. En particulier dans la Vallée de l’Huveaune : dans le quartier ouvrier de la Barasse, à l’Est de la ville, la vibe jamaïcaine s’empare des cœurs des jeunes prolos… Fénichel en boira le calice jusqu’à la lie. Il reconnaît d’ailleurs dans les notes de la jaquette du CD ce qu’il doit, entre autres, à un Jo Corbeau, qui transposa l’idiome yardie (« aïoli ») dans le parler local, avec force musiciens locaux d’exception — Alex Duthil passera d’ailleurs l’un de ses titres dans Open Jazz sur France Musique[1] !
A-t-il ressenti le besoin de renouer avec cette musique fondatrice de son identité de bassiste ? Car s’il est un instrument fondamental dans l’univers du reggae, c’est bien la basse. Ou même la contrebasse — du moins à l’époque du ska, jusqu’en 1967. Fénichel la veut légère, conférant une touche de féminité à un univers musical bien trop souvent marqué par un machisme infect — sans parler d’une homophobie répugnante. Les beaux traits d’archet en ouverture de Bongo Man, des légendaires Mystic Revelation of RastafaRI, font résonner toute la spiritualité d’une composition à l’origine uniquement jouée en percussions nyabinghi — un terme d’origine nigériane rappelant fièrement l’héritage ouest-africain de cette culture — et en envolées d’un saxophone joué par Cedric Im Brooks aux accents étonnamment coltraniens. Il fallait que figurât sur ce disque un hommage à Lloyd Brevette, le contrebassiste des légendaires Skatalites (car le reggae est une version ralentie de ce rythm’n blues jamaïcain qu’est le ska) : son Rock Bottom se voit ici gratifié d’une outro lorgnant vers un dub empreint d’accents free, élégant clin d’œil aux expérimentations rythmiques auxquelles se livrait le fondateur de l’école de basse yardie aux côtés de son complice, le batteur Lloyd Knibbs. Et cette ligne épurée, au groove sans pareil, sur Them Belly Full, un standard de Bob Marley composé par Carlton Barret, le frère du batteur Aston « family man », avec qui il formait une paire rythmique sans qui le chanteur des Wailers n’aurait certainement pas atteint les sommets artistiques ? Nul besoin de la voix soulful du prophète jamaïcain ici : il suffit de suivre le sillon des fréquences graves pour se surprendre à murmurer la rage contenue dans cette composition (« Ils ont le ventre plein, mais nous, nous avons faim »). Idem pour une révérence à Big Youth en introduction d’une composition : rendre hommage à celui qui incarna au mieux l’art du toasting sans faire usage de la voix, c’est une belle façon de rappeler toute la musicalité d’un art vocal dont est partiellement issu le rap… Car Fénichel et ses compagnons n’oublient pas que le reggae est une musique de revendications sociales.
Il fallait bien un batteur ouvert à d’autres cultures que le jazz (africaines notamment), mais avec un solide bagage free pour donner le “La” à la maestria bassistique du leader. Ainsi la fusion de son instrument avec la batterie de Braka (alias Gaston Braka, Simon Fayolle à l’état-civil, un baroudeur musical mais pas que, un de ces touche-à-tout au CV artistique impressionnant) devient-elle incandescente : entre les quatre cordes de l’un et les peaux et cymbales de l’autre, la syncope devient atomique. L’essentiel est bien là, dans cette quête éperdue du contretemps, qui provient de rituels chamaniques d’hyperventilation, si l’on en croit l’anthropologue Denis-Constant Martin(1). On attendra vainement quelque guitare faisant cette pompe à la croche caractéristique de la musique jamaïcaine (à peine émerge-t-elle subrepticement) : ici, Thomas Weinich, membre, comme le leader, de la Compagnie Nine Spirit, déploie toute sa culture blues voire bluegrass pour duper la caricature, déployant de somptueux arpèges là où on ne les attend pas (Doisnel in the sky, l’un des deux compositions de l’album), osant des dissonances saturées sur un titre comme Simple Song (autre composition originale), restituant la saveur expérimentale du dub originel.
Il fallait bien des cuivres sonnants et rutilants. Ici, Romain Morello, au trombone, développe des phrases gouleyantes à souhait, s’inscrivant dans les traces du mythique Don Drummond (tromboniste des Skatalites décédé dans les affres de la schizophrénie) et déployant toute sa sensibilité swinguante sur l’instrument, avec de redoutables accents bop — espérons que son enseignement dans la classe de jazz au Conservatoire de Marseille garde toute la saveur insulaire de son travail sur ce disque ! Quand ils se rejoignent, avec le trompettiste sud-africain Marcus Wyatt, improvisateur féru de Freddie Hubbard, ce trompettiste emblématique du jazz hard-bop, les sirènes de Babylone n’ont qu’à bien se tenir ! Par leur dialogue lorgnant vers l’improvisation débridée, les vents consolident l’expérimentation syncopée et, en empruntant des idiomes vraiment jazz, contribuent quelque part à l’universalisation (certes, c’est déjà le cas), voire à la laïcisation (encore un effort, camarades à dreadlocks) d’une musique trop souvent confite dans un prêchi-prêcha lassant(2).
Cet album, Frenchtown Connection, enregistré et mixé de main de maître par Antony Soler (par ailleurs batteur) au sein de l’Atelier des Musiques Improvisées de Château-Arnoux, dans le 04, est édité par l’impeccable maison Label Durance (dirigée par le guitariste Alain Soler, oui le frère du précédent), avec qui Fénichel a pour le moins des accointances musicales et humaines. Le titre est un jeu de mots entre « Trenchtown », du nom de l’un des ghettos de Kingston (ceux où l’on se fait la guerre sur fond de corruption et de trafics en tous genres…) et French Connection, le film policier de William Friedkin, qui, en 1971, faisait de Marseille l’une des plateformes mondiales de production d’héroïne et dont les scènes au commissariat furent tournées… au Conservatoire, comme le révèle Fénichel dans le texte d’accompagnement du CD — lui-même étant un ancien élève de la vénérable maison !
Le propos d’ensemble est d’une redoutable intelligence collective : le groupe finit par rappeler tout ce que les divers genres musicaux accolés au reggae (nyabinghi, ska, rocksteady, calypso, dub…) doivent au jazz, et inversement. Par une sorte de dialectique musicale, Pierre Fénichel et son gang esquissent la carte sensible d’une cité phocéenne fantasmée qui, quelque part, a quelque chose de la Jamaïque mais aussi de l’universel jazz. On se languit des prestations scéniques à venir, bomboclaat.
Laurent Dussutour
Frenchtown Connection est sorti le 15 octobre 2021 sur le label Durance.
www.pierrefenichel.net / label-durance.com
- Denis-Constant MARTIN, Aux sources du reggae, Marseille, Parenthèses, 1983[↩]
- Que disent des rastas qui n’ont plus d’herbe à fumer ? « – C’est quoi cette musique de m**** ? »[↩]
