
De notre monde emporté de Christian Astolfi (Le Bruit du Monde)
Bataille navale
Si c’était un film, il serait signé Robert Guédiguian ou Ken Loach. Mais De notre monde emporté est un roman, un très beau roman disons-le d’emblée, de Christian Astolfi, paru chez Le Bruit du Monde, maison d’édition récemment installée à Marseille.
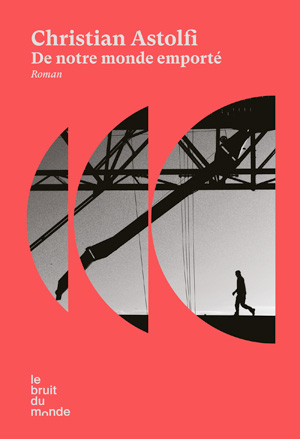 L’auteur, né dans une famille ouvrière, fut ouvrier à l’arsenal de Toulon, avant de bifurquer vers l’Éducation Nationale, où il s’occupera notamment de jeunes décrocheurs de retour à l’école. De notre monde emporté est son quatrième roman.
L’auteur, né dans une famille ouvrière, fut ouvrier à l’arsenal de Toulon, avant de bifurquer vers l’Éducation Nationale, où il s’occupera notamment de jeunes décrocheurs de retour à l’école. De notre monde emporté est son quatrième roman.
On y suit le parcours du narrateur, surnommé Narval, depuis le début des années 70 jusqu’à nos jours. Comme son père, il travaille aux chantiers navals de La Seyne, plongeant chaque jour dans l’univers de la machine avec quelques camarades, tous dotés d’un sobriquet : Mangefer, Barbe, Cochise, Filoche.
Leur vie est faite par et pour le travail, ce travail dont l’auteur nous fait ressentir les gestes, les sons, les odeurs, avec une grande puissance évocatrice. Les chantiers, les ouvriers, leurs familles, la ville, forment un tout, une communauté. « Depuis 1853, elle est là, à tenir la ville debout, à nourrir ses enfants. (…) comment imaginer à cet instant que tout cela, un jour, puisse disparaître. »
Car peu à peu les menaces se précisent ; arrivent les nuages nommés concurrence, rentabilité… jusqu’à ce jour de 1986 où tout s’arrête, où le pont levant reste inexorablement dressé, devenu inutile. Narval et ses camarades luttent, désespérément, en vain, leur vie est mise en demeure de changer, mais est-ce possible ?
Le narrateur entrelace à cette fresque ouvrière son autre vie, intime, avec Louise, si lumineuse, qui cherche sa place, avec son père, avec les bonheurs de la musique d’opéra et de jazz.
La politique est dans l’air : explosion de joie et d’espoir en 1981, désillusion brutale en 1983, « promesses et programmes qui ignoraient, d’où qu’ils viennent, jusqu’à l’existence de nos vies. » Un matin de 1986, un de ses camarades d’atelier reconnait même avoir « donné sa voix au borgne », comble de la désespérance. Nous sommes en 2022, et la fille du « borgne » a obtenu 52 % au second tour de l’élection présidentielle à La Seyne…
Les chantiers sont fermés, et après avoir été source de vie, ils vont se révéler fauteurs de mort. C’est l’insidieuse amiante, surnommée « la dame blanche », présente partout sur le chantier, qui des années plus tard, ronge la santé des ouvriers, selon une loterie macabre, dans le déni des autorités. « Le chantier était nos poumons, notre respiration, notre cœur. Le jour où leur sang est devenu vicié, leur santé dégradée, leur état irrémédiable, c’est notre propre corps, par contagion, qui s’est infecté. Leur maladie était la nôtre. »
Un autre combat commence, judiciaire celui-là : les anciens camarades s’y retrouvent ensemble, pour obtenir reconnaissance des fautes et réparation. Cette bataille dure toujours.
Narval retourne sur les lieux ; l’imaginaire recrée le monde emporté et nous livre quelques visions, comme celle d’une goélette mythique, la Zaca, grand bateau blanc amarré au quai des chantiers pendant un temps, disparu depuis.
Aidé par Louise, Narval finit par s’avouer que ce travail qui était sa vie, toute sa vie, fut aussi une forme de cancer dévorant, à l’instar de l’amiante. Et s’éclaire alors le poème placé en exergue, l’Ode à la Paresse de Pablo Neruda.
Tout cela pourrait nous donner un bon vieux mélo ; ce n’est pas du tout le cas. L’ambitieuse mosaïque de thèmes abordés — le travail, l’exploitation, la filiation, les désillusions du politique, la musique — est maîtrisée par une écriture très tenue. Une écriture vive, serrée, précise. Le rythme est soutenu, avec des chapitres courts, de deux à quatre pages chacun, et le vocabulaire étendu, avec notamment les mots du travail, de ses gestes, de ses outils. Les personnages s’ordonnent dans une sorte de polyphonie, le narrateur les actionnant comme des interprètes. « J’étais le scénariste, le metteur en scène, le monteur, le projectionniste (…) le personnage principal. J’étais la voix off. »
Décidément, en lisant ce texte qui fait si bien surgir images et sons, on ne peut s’empêcher de penser cinéma. Et de se demander si Jean-Pierre Daroussin accepterait le rôle de Narval…
Gabriel Ishkinazi
Christian Astolfi – De notre monde emporté (Le Bruit du Monde)
