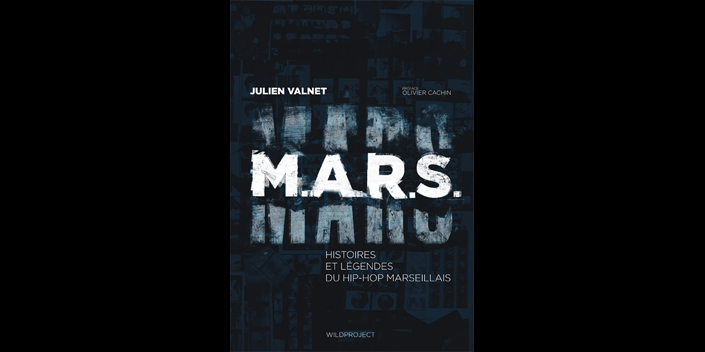M.A.R.S. : Histoires et légendes du hip-hop marseillais

L’Interview
Julien Valnet
« 2600 ans d’histoire derrière nous, et la France nous traite toujours comme une poubelle. J’en ai assez de voir ma ville humiliée », scandait IAM en 1991. Vingt-cinq ans plus tard, la maison d’édition marseillaise Wildproject motive un membre de l’équipe de l’A.M.I. (Aide aux Musiques Innovatrices) pour retracer le chemin parcouru par ce qui n’était au début qu’une bande de passionnés. Après une soixantaine d’interviews et un nombre incalculable d’heures de travail est né l’indispensable M.A.R.S. : Histoires et légendes du hip-hop marseillais, premier livre sur l’histoire du rap à Marseille. Rencontre avec son auteur.
Penses-tu que, à Marseille, les rappeurs ont dû, plus qu’ailleurs, faire face à un certain mépris émanant de la société française ?
C’est une question difficile. Je ne sais pas, mais plus j’y pense, plus je me dis qu’il y a une façon marseillaise d’être hip-hop. Les activistes hip-hop marseillais sont autant hip-hop que marseillais, avec tout ce que ça veut dire sur l’identité de la ville : une ville effectivement dominée. Un ami me dit que l’OM est la revanche symbolique sur cette domination. Une chose est sûre : les activistes hip-hop ont changé l’image de leur ville. Quelque part, ils sont aussi les petits-fils des raconteurs d’histoires comme Scotto, de ces chanteurs d’opérette marseillaise d’avant-guerre. Si tu compares le poids médiatique entre les kalachnikovs et la culture, ce sont les premières qui ont gagné. Et, finalement, ceux qui sont parvenus à modifier le plus l’image et l’identité de la ville, à écrire une histoire positive de Marseille, ce sont les gens du hip-hop. A part l’OM, personne d’autre n’a été capable de faire rêver, tout en critiquant, aussi. Ils écrivent un mode de vie.
D’où vient le rapprochement entre le hip-hop et le reggae à Marseille ?
L’une des premières émissions radiophoniques de rap marseillais, Prélude, sur Radio Star (créée par Philippe Subrini, qui sera également le fondateur de la Zulu Nation Marseille), se déroulait juste avant l’émission reggae/ragga de Jo Corbeau. Akhenaton et Shurik’n ont également fait leur première tournée avec Massilia. D’ailleurs, la première cassette d’IAM, Concept, est plus ou moins produite par Massilia, sur leur label Ròcker Promocion. Le modèle de développement est clairement l’alternatif, basé sur le modèle de Bondage Records, les Bérus etc. Il y a par contre une fracture en 1990, lorsque IAM signe sur Labelle Noire. Massilia reste dans l’indé et IAM se tourne vers « les grands Satans capitalistes ». Après, j’ai toujours pensé que Massilia et IAM sont les deux grands groupes marseillais.
Outre le fait qu’une partie de la famille d’Akhenaton vive aux Etats-Unis, pourquoi le hip-hop marseillais semble avoir toujours été plus connecté avec New York que Paris ?
Il y a toujours eu une vraie connexion entre New York et Marseille. D’une façon générale, les Marseillais semblent se passionner pour New York. Organise un sondage dans la rue, et demande la destination première de voyage à plein de personnes. Je suis persuadé que New York ressortira. Après, bien sûr, il y a les premières émissions de radio hip-hop à Marseille, dans lesquelles on téléphone à Bambaataa et bien d’autres. Chill (Akhenaton) part très tôt à New York, plusieurs fois. Kheops pareil. C’est là, en côtoyant le milieu hip-hop en plein essor, qu’ils acquièrent les techniques qui feront que lorsque la K7 Concept sortira en 1989, ils auront une longueur d’avance sur le reste de la France. D’ailleurs, en 1990, Chill dégote un taf de beatmaker chez Def Jam à NY et projette de ne pas revenir à Marseille.
Le lien continue par la suite. Pas mal vont y chercher des disques. L’album du Soul Swing, Le Retour de l’Âme Soul, possède un son typiquement new-yorkais. En même temps, le lien avec les Parisiens existe dès le départ : les rappeurs qui vont populariser Concept à Paris ne sont autres que JoeyStarr et Rockin’ Squat (de Assassin). Après, le lien avec New York doit sûrement remonter à plus loin dans le temps : je pense notamment à la French Connection…
Le hip-hop marseillais s’est-il, un jour, institutionnalisé ?
Si l’on entend par « institutions » les collectivités territoriales et locales, alors le hip-hop est resté peu soutenu. Par contre, le développement du hip-hop marseillais est très lié à l’industrie musicale. La preuve : aucun disque de hip-hop marseillais produit en indépendant n’a été disque d’or.
Penses-tu qu’il y a ce sentiment, pour les acteurs du hip-hop marseillais, d’appartenir à une seule et même grande famille ?
Oui, je crois. Le 31 août dernier, nous avons organisé, avec Dj Rebel, une série de tables rondes au MuCEM. L’amphi était plein. Et l’on a pu y croiser beaucoup d’acteurs du hip-hop marseillais, de toutes les générations. Ça s’est même terminé par une grande photo de famille avec tout le monde. Oui, il y a une forme d’unité, malgré toutes les différences.
Penses-tu qu’il y a un personnage central dans le hip-hop marseillais ?
C’est difficile de te répondre car j’ai écrit un bouquin pour montrer toutes les personnes cachées derrière les figures tutélaires, mais s’il faut en citer un, c’est Luciano. Il fait l’unanimité. Akhenaton, Keny Arkana, d’autres, te diront que c’est lui le plus grand.
Après 2000, tu parles d’une sorte de dispersion du mouvement…
Je suis en fait très intéressé par les questions relatives à l’indépendance, et ça oriente un peu mon regard. En tout cas, j’ai constaté que l’essor du hip-hop marseillais était lié à une industrie qui n’a investi que sur peu de groupes. Elle a son groupe marseillais et ça suffit. Les seuls qui « fonctionnent » aujourd’hui (Soprano, Keny Arkana) le font sur le modèle des majors. Puis vient la fameuse crise du disque, à l’arrivée des graveurs de CD et du téléchargement, qui aura pour effet induit — et tout particulièrement dans le hip-hop marseillais — le retrait des majors. Il y a peut-être d’autres facteurs, mais ce phénomène est prégnant. Il n’y a également pas eu de structures indépendantes qui ont pu prendre le relais. La FF aurait peut-être pu construire quelque chose à ce moment-là, comme l’a fait le Wu Tang. Mais en même temps c’est difficile de le leur reprocher. Ils ont vécu ce qu’ils avaient à vivre… Il n’y a qu’un exemple, celui de Mateo et Soprano avec Street Killz. Malgré tout, le hip-hop reste très créatif à Marseille.
Se structurer en collectif semble être une problématique récurrente à l’époque. Penses-tu qu’elle l’est encore aujourd’hui ?
Il y a toujours des mecs qui bossent en collectif aujourd’hui, je pense par exemple à M.O.H.. et aux gars de Soli Muzik. Si tu cherches un peu, tu vas en trouver. A la base, quand personne n’envisageait qu’ils pourraient un jour se faire de l’argent avec ça, il y avait une vraie énergie collective. Aujourd’hui, on peut envisager un plan de carrière dans le hip-hop. La musique préférée des 18-25 ans est, pour une immense majorité, le rap. Le fait qu’il soit devenu bankable a probablement dû modifier la conscience du collectif.
Internet a-t-il changé la donne ?
En 1989, IAM rencontre Imhotep car c’est le seul mec à avoir un sampleur ! Aujourd’hui, tu montes un studio dans ta chambre avec un ordi’, te permettant un accès plus large aux outils de production. Et en ce qui concerne la diffusion de la musique, tu peux d’ailleurs constater un vrai décalage générationnel. Sachant qu’il est aujourd’hui possible de tourner et monter des clips, hyper bien, dans la même journée. Tout le monde peut se payer une petite caméra.
Pourquoi situe-t-on l’âge d’or du hip-hop marseillais dans la seconde moitié des années 90 ?
En effet, toute le monde s’accorde à dire qu’il y a eu un âge d’or du hip-hop marseillais autour 1995-2002, avec une croissance en termes de groupes, de qualité artistique et d’investissements de producteurs. En gros, du Mia à la crise du disque. Un âge d’or est lié à la conjonction de deux choses : une qualité artistique (un son marseillais qui défonce, le meilleur son d’Europe), et un succès phénoménal en termes de diffusion (avec L’Ecole du Micro d’Argent, IAM a vendu plus d’un million et demi d’albums). A cette époque, tous les disques qui sortent en major sont disques d’or.
Quels sont aujourd’hui les grands défis du tissu musical marseillais ?
Inventer le modèle économique qui lui permettra d’être véritablement indépendant. Et travailler d’égal à égal, en trouvant des modèles qui ne soient pas verticaux, et qui ne passent pas par les centres. Il y a un truc que j’aime beaucoup dans le hip-hop, c’est le « For Us By Us »…
Penses-tu que, musicalement parlant, on vive une époque formidable ?
Oui, je le pense. Nous avons, aujourd’hui, soixante-dix ans de musique enregistrée derrière nous. Autant de sources d’inspirations pour faire tomber les barrières. Quand les rappeurs ont commencé, on leur a dit que ce qu’ils faisaient n’était pas de la musique… Aujourd’hui, on s’en fout et c’est cool ! Arthur H a nommé un de ses albums Négresse Blanche pour évoquer le fait qu’il n’y a plus de frontières entre les genres, et que c’est très bien comme ça. L’avenir est excitant.
Propos recueillis par Jordan Saïsset