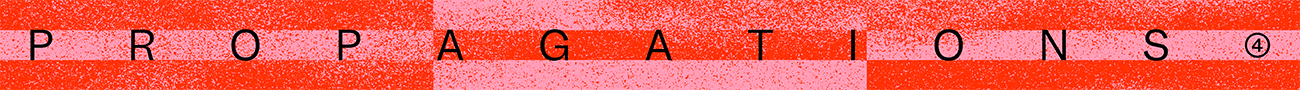Si elle est libre comme le sont la parole dans le slam ou la musique dans le jazz, si elle est aussi féconde que quelques mots placés ensemble dans les chefs-d’œuvre de la littérature ou de la chanson française, la vision d’Abd Al Malik est une et indivisible, à l’image de cet idéal… (lire la suite)

Si elle est libre comme le sont la parole dans le slam ou la musique dans le jazz, si elle est aussi féconde que quelques mots placés ensemble dans les chefs-d’œuvre de la littérature ou de la chanson française, la vision d’Abd Al Malik est une et indivisible, à l’image de cet idéal français qu’il est aujourd’hui l’un des rares à personnifier. Cette année, le jury du Prix Constantin n’a donc pas seulement consacré un artiste, mais un symbole. Dont le propos est d’une intelligence, d’une justesse et d’une limpidité telles qu’il vaut bien tous les manuels scolaires, dont Hollywood pourrait faire un film : l’anti-8 Mile par excellence. Mesdames et messieurs, se passerait-il ici quelque chose ?
Ton parcours d’adolescent est édifiant : tu as grandi dans une cité « difficile » de Strasbourg en jouant constamment un double rôle, à la fois lycéen brillant et délinquant respecté par ses pairs, ce qui t’as permis de slalomer en terrain miné mais a aussi failli te coûter ta santé mentale. Peux-tu nous expliquer comment, à ce moment précis, Régis est devenu Abd Al Malik ?
Comme beaucoup de jeunes qui vivent dans les quartiers, je suis rentré dans la délinquance pas tant parce que j’étais « méchant » que pour ne pas être séparé du groupe. Lorsque je regardais par la fenêtre de mon immeuble, mes modèles étaient des voleurs de voitures, des braqueurs, des dealers… Tout le monde les respectait quand ils parlaient : je voulais simplement être comme eux. Mais en parallèle, j’avais une passion pour le savoir, et en particulier pour la littérature, qui a fait qu’une institutrice a fait des pieds et des mains pour que je puisse aller dans un collège hors de la cité – un collège privé catholique. C’est là que j’ai commencé à avoir cette démarche de vie schizophrénique : bon élève pendant la journée, délinquant le soir… Au début, c’étaient des petits vols à l’étalage, rien de bien méchant, mais ensuite c’est devenu du vol à la tire, du deal… Et puis il s’est passé quelque chose lors d’un vol à l’arrachée avec un ami : j’ai été horrifié de voir cette dame par terre, alors qu’on voulait lui prendre son sac, ça m’a bouleversé dans le sens où je me disais que je ne pouvais pas continuer comme ça. J’ai donc levé le pied, puis il s’est passé quelque chose de fondamental qui m’a fait rompre définitivement avec la délinquance : l’héroïne est arrivée dans notre quartier. Beaucoup d’amis à moi sont tombés là-dedans : certains sont morts d’overdose, jeunes, à côté de moi, d’autres ont fini en prison avec de lourdes peines pour trafic, d’autres encore en asile psychiatrique… Ça a été un vrai traumatisme. J’ai éprouvé le besoin d’en parler avec d’autres – c’était trop lourd à porter – et c’est comme ça qu’on a décidé de monter notre groupe de rap, les New African Poets (N.A.P). On parlait de ce qu’il se passait dans notre cité : le rap comme une catharsis. Avec ce rapport direct à la mort, j’ai commencé à me poser beaucoup de questions existentielles, et c’est là que je me suis tourné vers la spiritualité. J’avais un vrai besoin d’absolu. J’ai d’abord questionné le catholicisme de mes parents, puis celui des religieux dans les établissements où j’étudiais, mais j’avais le sentiment que le christianisme ne répondait pas à mes questions. Mon frère aîné Bilal, qui était déjà rentré en Islam, me passa alors des ouvrages : ce fut comme si j’avais affaire à ma religion naturelle, et c’est ainsi que je le suivis. Malheureusement, et comme cela arrive souvent dans les quartiers, les personnes qui sont venues me parler d’Islam – religion de paix, d’amour et de respect – m’ont présenté une vision obscure de la chose : il faut comprendre que j’avais seize ou dix-sept ans à l’époque, et je suis rentré en Islam comme certaines personnes prennent leur carte du PC ou deviennent voyous… L’Islam était une sorte de fêlure identitaire : je l’ai brandi comme un étendard, alors que la spiritualité n’est pas de l’ordre du privé mais de l’intime, qui nous pacifie dans notre rapport à l’autre. J’avais donc une vision idéologisée de la chose, et j’allais de ville en ville pour la prêcher. Ma vie schizophrène continuait : je faisais de la musique, j’étais un étudiant brillant, je prêchais, et ces trois vies n’interféraient pas les unes dans les autres. Jusqu’au jour où je me suis rendu compte que l’Islam était une prison qui ne correspondait pas à cette vie-là. D’un côté, j’avais l’impression de grandir et de m’ouvrir, de l’autre, celle de régresser. C’est là que j’ai découvert le soufisme : le cœur de l’Islam. Je suis rentré sous la guidance d’un maître spirituel, et à partir de là, ma vision des choses a explosé, elle est devenue « une », je me suis aperçu que cette vie religieuse ne coupait pas des autres, que « l’autre » était essentiel pour être « moi »… Avec N.A.P, on cherchait toujours la responsabilité chez l’autre. Avec le soufisme, j’ai cherché quelle était ma propre part de responsabilité : que pouvais-je faire pour améliorer mon contexte ? J’ai trouvé là l’occasion de sortir mon premier album solo, et mon premier ouvrage en tant qu’écrivain[1].
Justement : avec ton travail en solo, tu entérines l’idée que la musique reste l’un des plus puissants vecteurs pour faire passer un message. Mais tu as également écris ce livre, dont le titre, et donc le contenu, aurait difficilement pu supporter un équivalent calibré pour les radios : Qu’Allah bénisse la France. La pluralité des supports est-elle aujourd’hui une clef pour pouvoir tout dire ?
Oui, et en même temps, le fait d’être artiste et l’engagement vont de pair : parler d’artiste engagé est un pléonasme. Ma démarche est artistique : je suis un fou de littérature. Et depuis longtemps, j’avais envie d’utiliser un support autre que celui de la musique, un support qui me permettrait de prendre le temps, d’utiliser une autre méthodologie de travail. Pour autant, j’ai le sentiment qu’on peut tout dire avec la musique. J’aime des gens aussi divers que Nas, Brel ou Coltrane, et je voulais faire un disque où tout cela soit palpable, que l’on puisse écouter comme un recueil de nouvelles, et en même temps un disque hip-hop dans le sens où, pour moi, le rap est la seule musique qui soit organiquement faite de toutes les autres – par la culture du sample. J’avais envie de donner un coup de pied là-dedans, de faire une révolution au sens étymologique du terme, c’est-à-dire revenir à l’essence même du hip-hop. Dans Gibraltar, il n’y a pas de frontières musicales, culturelles ou générationnelles. D’où son nom : j’avais envie de faire du lien. La musique, c’est la rencontre, le dialogue.
Cet album a une couleur jazz très présente, que l’on peut aussi retrouver dans les récents albums de rappers comme Rocé ou Oxmo Puccino. La forme très libre de ce courant musical serait-elle le plus bel écrin pour épouser une parole en mouvement ?
Oui, mais j’ai presque envie de dire que ça s’est fait par accident. Lorsque Bilal, mon frère, a commencé à composer des titres, il a samplé des trucs comme Nina Simone. Quant à moi, pendant l’enregistrement, j’ai beaucoup écouté Kind of Blue de Miles Davis : ça m’a inspiré, et puis on a réalisé le disque avec Régis Ceccarelli qui vient du jazz, donc tout cela s’est fait très naturellement. Je me désigne souvent comme le « fils de l’instant », qui se nourrit de l’inspiration du moment pour pouvoir se renouveler à chaque fois.
Le slam, discipline encore très underground en France il y a peu, est soudainement devenu populaire auprès d’un public jusqu’alors peu enclin à écouter du hip-hop : le succès de Grand Corps Malade en atteste. Comment expliques-tu ce regain d’intérêt pour le texte ?
Nous vivons dans le monde du phénomène, de l’immédiateté, où l’on passe vite d’une chose à l’autre. J’ai le sentiment que nous éprouvons tous le besoin de s’arrêter, de s’écouter, d’expliquer. Et forcément, lorsqu’une discipline du mot et du verbe comme le slam ou le « spoken word » apparaît, ça fait écho en chacun de nous. Lorsqu’on déclame un texte de la sorte, on le médite, on essaie de le comprendre : c’est une démarche que l’on a envie d’avoir mais qui n’est pas répandue. Pour ma part, je n’ai fait qu’utiliser cet élément-là : je suis avant tout un rapper, qui souhaite redonner ses lettres de noblesse au rap. Nous autres les rappers, nous ne sommes pas des animateurs sociaux avec un micro, mais des artistes. Le Prix Constantin que je viens de recevoir en atteste : cela me remplit de joie pour la communauté hip-hop. Et va peut-être aider à casser les préjugés.
N’y a-t-il pas un danger à ce que le slam devienne, en France, une certaine forme de hip-hop politiquement correct à destination des bobos ?
Qu’importe. L’essentiel, c’est la sincérité des artistes, leur capacité à mettre leur cœur et leurs tripes dans leur musique, leurs mots. Si on est face à des artistes sincères, on ne peut pas les rabaisser à une forme « d’art pour grand public ». L’art doit transcender les chapelles, il doit aller vers l’autre, quels que soient sa religion, couleur de peau ou milieu social.
Tous genres confondus, peux-tu me citer cinq références qui pourraient à elles seules refléter ton travail, éclairer nos lecteurs quant à ta démarche ?
Tout d’abord, Jay-Z, parce qu’il a amené le hip-hop à un autre niveau, tant pour son ouverture d’esprit que pour son sens des affaires. Jacques Brel, pour sa force d’interprétation, cette capacité à tout donner, son écriture si particulière. Miles Davis, pour cette force artistique déployée avec son seul instrument, la contestation sans les mots, un certain mysticisme… L’écrivain Raymond Carver, dans le fait de parler de son peuple : les petites gens. D’histoires simples, fragiles, particulières, il fait quelque chose de grand. Sa simplicité d’écriture est quasi-métaphysique. C’est aussi ce que je veux faire. Et il m’en reste un, donc… Je dirais… Wallen, la chanteuse de r’n’b. Et pas parce que c’est mon épouse. Mais parce que je l’admire beaucoup artistiquement : elle a rendu majeure une musique que je considérais comme niaise. Elle a une sensibilité folle. Cela va bien au-delà du r’n’b.
A l’approche de Présidentielles plus que jamais très symboliques, comment vois-tu l’évolution de la situation dans les banlieues défavorisées ?
Dans notre pays, il n’y a qu’une seule communauté qui compte : la communauté nationale. La France d’aujourd’hui n’est plus la même que la France d’hier, sa diversité n’est pas une tare, c’est un cadeau. Je pense qu’il est essentiel qu’on reconnaisse cette diversité. Or aujourd’hui, on sait bien que dans les quartiers, nous sommes les premiers à être victimes des discriminations et de la précarité. L’impérieux devoir républicain est aussi d’aider les plus faibles : je suis avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui vont dans le sens du rassemblement. La France est un merveilleux pays, avec des valeurs philosophiques aussi fortes que la liberté, l’égalité, la fraternité… Les notions de laïcité, républicaines et démocrates, sont essentielles, et il faudrait que les Politiques se rendent compte qu’il faut aider TOUTE la communauté nationale. S’ils continuent à mettre de côté cette partie de la communauté, il pourrait advenir quelque chose de pire que les événements de novembre 2005. Mais si les Politiques ont une responsabilité, nous avons aussi la nôtre : celle de leur dire ce qu’on attend d’eux, et surtout de voter pour les personnes qui vont amener ce changement positif. Je ne vais pas dire qu’il faille aller à gauche ou à droite : je ne suis ni de gauche, ni de droite. Mais avec tous ceux qui pourront faire avancer les choses ensemble.
Plus concrètement, quelles sont les solutions que tu préconises pour éviter le pire ?
Il faut un plan Marshall pour les quartiers. Citoyens, politiques, assos sur le terrain : on doit tous se rassembler pour trouver ce qu’il est possible de faire. Et ce n’est pas qu’une question d’argent, mais d’intelligence, au-delà des familles politiques. C’est une démarche républicaine qui nous concerne tous.
Le collectif Devoir de mémoire, t’en penses quoi ?
Beaucoup de mes pairs, aujourd’hui dans le rap, crient tout haut « nique Sarko ». Je pense qu’il faut faire attention à ça, c’est dangereux : critiquer quelqu’un, c’est critiquer ses idées. Encore faut-il en amener d’autres. Quant au vote, c’est la fin de quelque chose et le début d’une autre : un acte de transition. Si on va aux urnes avec la haine, on ne pourra pas amener quelque chose de positif. Il faut y aller avec l’envie de construire. Donc, voter c’est bien, mais il faut avant expliquer comment fonctionne le système républicain. Il faut faire de la pédagogie et pas simplement dire « voter, c’est une arme ». Il faut amener de la nuance dans le propos.
Propos recueillis par PLX
Photo : Bernard Benant
Le 2 à l’Affranchi, 21h. Rens. 04 91 35 09 19 Dans les bacs : Gibraltar (Atmosphériques)
Notes
[1] Qu’Allah bénisse la France (Albin Michel)