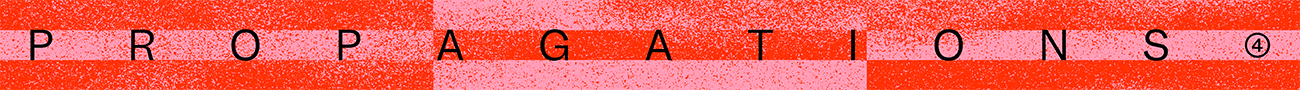Opération culturelle et pouvoirs urbains de Nicolas Maisetti

L’interview
Nicolas Maisetti
Après l’anthropologue Michel Peraldi, nous avons souhaité faire suite à ce que l’on pourrait appeler un « cycle sociologique autour de Marseille » en donnant la parole au docteur en science politique Nicolas Maisetti. Auteur du livre Opération culturelle et pouvoirs urbains. Instrumentalisation économique de la culture et luttes autour de Marseille-Provence Capitale européenne de la culture 2013, il se place en interlocuteur privilégié pour analyser les rouages de l’année Capitale.
Il semblerait que lorsque l’on révèle les dessous de l’entreprise de Marseille-Provence 2013, on sort de fait d’une sorte de neutralité.
La sociologie politique est une science critique. Pas dans le sens de la dénonciation, mais dans celui d’établir une distance avec un certain nombre de processus politiques. Bien que ça n’empêche pas le chercheur d’avoir son opinion, ni le fait que les résultats de ses recherches alimentent une critique. La question est importante parce qu’elle soulève l’enjeu de l’intervention du sociologue dans le débat public, ne serait-ce parce qu’il ne peut pas ignorer qu’il fait partie de ce qu’il observe. La distance, ce serait de ne pas être complètement dégagé, ni bien sûr d’adopter une posture de militant, engagé dans une cause (pour dénoncer ou pour légitimer des pratiques).
Que pensez-vous de la distorsion entre la communication de MP 2013, le fait qu’elle prône un élan commun, et la réalité de ses enjeux économiques entrepreneuriaux ?
Ils ont au contraire assumé cette dimension économique en tant qu’opération visant à améliorer l’attractivité du territoire, à utiliser la culture comme un outil de dynamisme économique. C’est posé comme tel dans le dossier : créer une alliance entre les acteurs économiques, les personnels politiques de l’agglomération et le secteur culturel. Le choix de Marseille en 2008, fait par le jury des Capitales européennes de la culture, liait d’ailleurs directement cette prétendue « alliance » entre les acteurs économiques, politiques et culturels. Mais cette idée selon laquelle la culture permet d’être un potentiel levier économique et un facteur de cohésion politique important n’est pas une invention de la Chambre de commerce de Marseille, cela remonte à plus loin, disons les années 1980. Ce lien est souvent affiché comme tel, à gauche comme à droite.
D’où émane cette volonté ?
C’est ce que Vincent Dubois et Kevin Matz, sociologues à l’Université de Strasbourg, appellent la « doxa économico-culturelle », un discours qui n’est réfuté ou contesté par personne. Cette remarque renvoie au « tournant gestionnaire des politiques culturelles » des années 80, qui correspond à la période Jack Lang à la tête du ministère de la Culture (1981-1986 et 1988-1992). Il s’inscrit dans le contexte plus large de la domination du néo-libéralisme qui s’impose en Europe avec Thatcher et aux Etats-Unis avec Reagan, mais qui se diffuse assez largement au-delà des gouvernements conservateurs. Les politiques culturelles n’y ont pas échappé, d’autant plus qu’un certain nombre de territoires connaissent alors un déclin industriel important. Les économies culturelles sont donc apparues comme un moyen pour négocier cette transition post-industrielle. Ce n’est bien sûr pas propre à Marseille ; on le retrouve un peu partout en Europe, notamment en Angleterre, avec le développement de politiques destinées à changer et à améliorer les « images » de villes qui déclinent sur le plan industriel, comme le montrent les travaux de Max Rousseau. Un certain nombre de maires se lancent alors dans une course aux grands événements qui reposent sur des opérations de requalification et d’aménagement urbains. C’est ici qu’intervient la culture, dans une perspective de développement économique.
Mais là où l’industrie faisait vivre tout un territoire, cette économie-là est presque anecdotique…
Oui, on peine à trouver une réalité objective au fameux « 1 euro investi, 6 euros de retombées » mis en avant par MP 2013. Ça alimente surtout des filières adjacentes, comme l’hôtellerie, la restauration, les économies touristiques en général. Les cibles de ces nouvelles politiques urbaines ne sont plus (en tout cas, plus seulement) les populations locales mais « des classes visiteuses » pour reprendre l’expression de Peter Eisinger, c’est-à-dire des populations exogènes au territoire : des investisseurs internationaux, des touristes, éventuellement des médias nationaux et internationaux pour agir sur l’image. Et évidemment au bout du bout, l’enjeu est d’attirer des entreprises et les classes moyennes supérieures (qui peuvent payer des impôts, consommer… et qui, pour certaines, votent encore), qui sont les nouveaux destinataires de ces politiques dites entrepreneuriales. Les cibles ne sont donc pas les mêmes que dans un système productif de type industriel.
Mais n’est-ce pas source d’inégalité et de marginalisation des acteurs culturels locaux ?
Là, on peut en venir à la critique à partir de ces observations sociologiques. On voit bien tous les risques qui ont accompagné le développement de ces politiques : redessiner la ville pour des cibles extérieures, ce qui peut aboutir à des processus de désappropriation de certains espaces. La géographie radicale appelle ce phénomène (pour aller vite) « l’accumulation par dépossession » : le développement économique s’accompagne d’un accroissement des inégalités. Cette thèse va donc à l’encontre d’une idée commune au néo-libéralisme et au socialisme de l’offre qui considèrent que l’accumulation des richesses profite, par « ruissellement », au plus grand nombre (en anglais, trickle down theory).
Pour revenir à MP 2013, il est difficile, quand on a ces éléments en tête, même s’ils peuvent paraître théoriques, de séparer l’opération de la capitale culturelle avec le projet urbain Euroméditerranée, et plus largement le tournant entrepreneurial des politiques urbaines à Marseille avec la multiplication des centres commerciaux, le développement des croisières, les candidatures aux grands événements, etc. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles on a vu apparaître à Marseille des contestations (même si elles n’étaient pas particulièrement structurées) visant à dénoncer les liens entre aménagements, requalifications et expulsions dans le centre-ville, en somme à s’opposer à cette vision d’une ville (fabriquée pour les) « 5 étoiles ». On le voit dans le Nord de l’Europe : les grands projets culturels s’adossent à des projets de requalification urbaine qui ont pour effet l’éviction des catégories populaires des hyper-centres. C’est l’exemple de la Rue de la République, mais également de ce qui se passe à Noailles autour du cas emblématique de l’îlot des Feuillants. Ces objectifs ont des effets importants sur la ville. C’est à partir de ce contexte que j’avais essayé d’identifier trois types d’attitudes des milieux culturels et artistiques à l’égard de l’opération Capitale.
Le premier groupe est composé de ceux qui ont participé à la Capitale européenne de la culture ou, en tout cas, qui ont essayé en déposant un dossier pour demander labellisation et financement. Tout simplement parce que c’est leur métier : faire des spectacles, monter des expositions, proposer leurs œuvres à des publics, le tout en bénéficiant d’une exposition inédite. La deuxième attitude partait quant à elle d’une critique relative à la fonction de la culture dans la ville. Une « culture » qui ne serait pas un simple outil du développement économique ou des politiques de « régénération » urbaine. Par ailleurs, ils exprimaient la volonté que les artistes moins en vue soient représentés durant l’année Capitale. Ils pressentaient que les complexités bureaucratiques (montage de dossier, logistique et notoriété) d’une telle opération et « l’exigence internationale » portée par MP 2013 ne leur auraient pas permis de figurer dans la programmation. C’est cette démarche qui a débouché sur le Off. Peu à peu, cette critique, qui entendait au départ fournir une alternative, s’est institutionnalisée, c’est-à-dire qu’elle est rentrée dans une logique de production d’événements culturels avec tout ce que ça implique en matière de maîtrise technique, de financement et de gestion, un peu comme MP 2013 au fond, même si les budgets n’ont pas été comparables : 450 000 euros pour le Off contre 91 millions pour le In… Enfin, notons que c’était la première fois qu’il y avait un Off dans l’histoire des capitales de la culture.
Le contexte y était assez proprice et renvoie à une troisième forme d’attitude à l’égard de MP 2013. Il s’agit aussi d’une critique, mais cette fois plus radicale. On la retrouve dans le mini-documentaire de Kenny Arkana (Capitale de la Rupture), mais aussi dans le remarquable film de Nicolas Burlaud, La Fête est finie. Il y reprend l’idée selon laquelle ces grands-messes seraient un « cheval de Troie » du capitalisme, en faisant entrer, sous couvert de « culture », la surveillance et la disciplinarisation, l’éviction des catégories populaires et l’impératif de rentabilité. « La Fête est finie » était d’ailleurs aussi le nom d’un collectif monté pour contester l’opération Lille Capitale européenne de la culture en 2004. Reprenant une éthique debordienne, ces contestations ont le grand mérite de poser une question très simple : faire la fête, pour/quoi ? pour qui ?
Comment se fait-il donc qu’il n’y ait pas eu une contestation plus massive ?
Il y a quand même eu des contestations réelles, mais qui se déplacent pour porter par exemple sur les phénomènes d’embourgeoisement du centre-ville. Certains collectifs ont été très actifs dans la période. On pourrait citer Pensons le matin, mais pour rester dans la critique plus radicale, on peut penser à ce qu’il s’est passé lors du carnaval de la Plaine, qui avait fait l’objet, en 2014, d’une intervention policière particulièrement violente.
Cela dit, il est difficile de nier certaines formes d’appropriation de la part de certains Marseillais (pas tous) de certains espaces et usages liés à la capitale européenne, ainsi qu’une redécouverte positive de Marseille pour un certain nombre d’habitants de la Région, voire au-delà. Comme on l’a dit : avec tous les problèmes que pose cette façon de construire la ville pour des populations cibles des politiques entrepreneuriales, ainsi que cette curieuse manière de transformer les habitants de leur ville en « visiteurs » (des nouveaux musées, des nouveaux centres commerciaux, des nouvelles rues et espaces…).
Mais au fond, une partie des publics a répondu présent en assistant à un certain nombre d’événements dans la programmation, comme le montre le programme de recherche « Publics et pratiques culturelles dans MP 2013 » dirigé par Sylvia Girel, sociologue à l’AMU. L’objectif étant de vendre Marseille comme destination. D’une certaine façon, ça a marché au-delà des espérances initiales de la CCI, puisqu’ils ont réussi à vendre cette destination aux Marseillais eux-mêmes. L’idée était donc de s’appuyer sur ce type de grandes manifestations avec un prestige international pour vendre une série de produits touristiques : le savon, la Bonne Mère, le Vieux-Port, jusqu’à l’identité provençaliste refabriquée avec les moutons sur le Vieux-Port.
Et le MuCEM dans tout ça ?
Le MuCEM fait partie de ces objets devenus incontournables dans la production des villes contemporaines. Déjà, c’est un signe architectural fort, le symbole de ce « nouveau Marseille », comme on en trouve dans de très nombreux endroits en Europe. Le précurseur, c’est évidemment le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao. L’idée étant de construire un musée en redynamisant l’espace dans lequel il se situe. Du coup, le contenu du musée importe beaucoup moins que le signal architectural. Mais quand on y réfléchit, c’est fou de dépenser 300 millions d’euros pour un signal architectural vide. J’avais été frappé de voir, au lendemain de la soirée d’ouverture, qu’on pouvait visiter le musée… vide. Et je faisais partie de ces visiteurs à qui on proposait une enveloppe spectaculaire vide d’œuvres et de sens, autre que celui de dire au marché : « Venez-voir cette ville qui change ! » Le musée n’ouvrirait la porte de ses expositions que six mois après, mais l’essentiel était accompli. On connaît aujourd’hui le dilemme de la direction du MuCEM parce qu’il y a beaucoup de visiteurs qui viennent voir le musée, le bâtiment, mais peu qui y rentrent pour les expositions (le rapport serait de un sur trois). Ça pose de fait le problème de la fonction des musées dans les villes. Ils ne sont au final que des équipements qui ont pour fonction de permettre à la ville de se distinguer dans la compétition internationale des territoires. Le paradoxe, c’est que pour armer cette stratégie de distinction, les élites urbaines investissent lourdement dans des bâtiments similaires.
On peut donc y voir un processus de normalisation…
L’événement Capitale européenne de la culture accélère ce processus, mais c’est une évolution de long terme. Et oui, qui dessine un processus de standardisation de la ville. Une nouvelle fois : la ville pour qui ? On refait la façade portuaire de la ville, le « water front », comme une carte d’identité censée sauter aux yeux de l’investisseur, du touriste ou du néo-arrivant, et on dit « Voilà le nouveau Marseille ». Mais le nouveau Marseille pour qui et qui va où ? « Marseille accélère » et « change », mais dans quelle direction, pour devenir quoi ?
Mais Paris a connu le même phénomène bien plus tôt, avec ce processus de muséification du centre vidé de ses classes populaires. N’analyserait-on pas plus ce phénomène ici qu’ailleurs ?
Oui, mais le cas de Paris est bien renseigné quand même sur ce point (Anne Clerval et son travail sur Paris sans le peuple, pour ne citer qu’un exemple). Les contextes dans lesquels ces enjeux se posent d’une ville à l’autre ne sont pas forcément les mêmes, mais ils sont présents partout. Le processus est en cours à Marseille, et son exécution y est très rapide, me semble-t-il. D’ailleurs, en jouant au jeu des stéréotypes, on parle souvent du retard et de la lenteur à Marseille. Alors, le retard, ok, mais la lenteur, pas du tout. Plus sérieusement, Marseille est engagée dans une évolution que d’autres villes européennes ont connu il y a dix, vingt ans. On peut donc voir comment ça s’est passé, et notamment très mal. Je pense à Valence, en Espagne, qui a misé sur ce type de politiques urbaines entrepreneuriales reposant sur le développement touristique à partir de grands événements. La ville est désormais ruinée. Je vous invite d’ailleurs à lire le très bon papier publié sur le sujet par Slate.fr, et signé par le chercheur en sciences de gestion Fabien Pécot.
On peut s’attendre au pire alors à Marseille…
Avec le recul, on pourrait se rendre compte des risques… Mais j’ai tendance à considérer qu’il y a quand même des formes de résistance face à cette violence entrepreneuriale. Je sais qu’Un Centre-ville pour Tous est en passe de sortir une étude importante sur la Rue de la République. Les Ateliers des Feuillants continuent sur le projet d’hôtel de luxe et de « brasserie branchée » à l’entrée de Noailles. A la Plaine aussi, il y a des résistances, autour du réaménagement de la place Jean Jaurès notamment. Face à cet alignement des politiques publiques sur des intérêts économiques, j’ai encore la faiblesse de croire dans la capacité de résistance de groupes mobilisés pour le contester. Qui accompagne ces transformations du centre-ville ? Là se jouent des choses essentielles, car elles ne sont pas anecdotiques.
A propos de la métropole, vous dites qu’elle n’a pas fonctionné en 2013, alors que l’enjeu y était central.
D’un côté, ça a plutôt marché au sens où, effectivement, MP2013 a instauré des routines de coopérations entre des acteurs publics et privés, et parmi les collectivités locales entre elles. Mais « routines de coopérations », ça ne signifie pas « coordination ». Au contraire, alors que le projet avait pour but la mutualisation des gains escomptés, chacune des collectivités a tenté de négocier en faveur de sa paroisse. Je pense à Maryse Joissain notamment, au retrait de Toulon, et surtout au fait que beaucoup de communes n’étaient pas prêtes à payer pour des événements qui ne se passaient pas chez elles. Elles avaient saisi la dimension du retour sur investissement, mais pas la dimension métropolitaine du projet.
C’est plutôt assez désespérant si l’on pense au 1er janvier 2016 qui verra la création d’Aix-Marseille, parce que s’il n’y a pas appropriation de cette métropole par les acteurs locaux, et en particulier par les élus, ça ne peut pas marcher. Le fait que l’Etat tape du poing sur la table est important, mais ça ne fait pas tout. D’un autre côté, ces difficultés sont plutôt encourageantes pour ceux qui s’opposent à la métropole. Et il ne s’agit pas là que de Maryse Joissain, qui a monopolisé médiatiquement ce discours critique sur le registre du « On va pas payer pour les délinquants des quartiers nord de Marseille ». C’est complètement absurde et caricatural, et ça masque d’autres types de critiques qui préfèrent questionner la pertinence de la création de grosses unités autour d’objectifs de compétitivité et de concurrence entre les territoires. Pourtant, on est ici comme ailleurs, dans un territoire marqué par l’inégalité et où le problème n’est pas tant la création de richesses que leur répartition. MP 2013, au fond, avait le même objectif. L’a-t-il relevé ?
Propos recueillis par Jordan Saïsset
Opération culturelle et pouvoirs urbains. Instrumentalisation économique de la culture et luttes autour de Marseille-Provence Capitale européenne de la culture 2013 (L’Harmattan, 2015) est disponible en librairie.
Rens. : www.editions-harmattan.fr